| |
26-02-2026 19-02-2026 12-02-2026 05-02-2026 29-01-2026 22-01-2026 15-01-2026 18-12-2025 11-12-2025 04-12-2025
|
|
[visuel-news]
04-12-2025
|
La chronique
de Gérard-Georges Lemaire |

|
| Chronique d'un bibliomane mélancolique |

Je m'empare du monde ou qu'il soit, Letizia Battagia, Sabrina Pisu, traduit de l'italien par Eugenia Fano & Géraldine Bretault, Actes Sud, 400 p., 23 euro.
De toute évidence, le sujet de cet ouvrage est Letizia Battaglia (1935-2022), photographe reconnue, qui s'est intéressée tout spécialement à la criminalité mafieuse à la fin du siècle dernier. Cependant, cette femme exceptionnelle fait s'interroger le lecteur sur différents aspects de son existence. Elle s'est mariée et a eu deux petites filles qu'elle a tenu à élever bien qu'elle était attirée par un grand nombre de choses bien éloignée de son état de mère de famille. Au fond, rien ne la prédestinait à avoir une existence échappant aux poncifs patriarcaux. Elle déclare dans ces pages qu'elle est née à trente-neuf ans. Elle a été attirée par la photographie. Elle a longtemps collaboré avec le journal sicilien L'Ora. Dans sa ville natale, elle a créé un petit centre culturel qui est devenu à la fois un musée de la photographie et le lieu d'archives de la criminalité organisée de cette ville qui a atteint alors son point culminant. Il y avait quelque chose de particulièrement courageux dans sa démarche, mue par une curiosité insatiable qui allait bien au-delà d'une sorte de fascination pour un monde qui possède une longue tradition criminelle. Dans l'actualité la plus crue, et par conséquent dans les films, les romans, les documents de presse, Palerme est devenue la cité de la Mafia et rien d'autre. Tout son passé glorieux, des Grecs anciens aux Romans, des Arabes aux Normands, puis à l'Espagne des Bourbons et enfin à l'intégration dans l'Italie moderne est comme gommé au profit d'une réalité sordide où le meurtre est la valeur suprême. Et ce n'est pas près de terminer.
L'histoire de Letizia Battaglia nous incite à voir les choses autrement : le choix de sa carrière est là pour mettre à bas les lieux communs de la société sicilienne qui repose sur des fondements patriarcaux ancestraux et qui sont ceux qui ont permis à Cosa Nostra de s'imposer comme modèle exclusif d'une société qui ne saurait avoir d'autre origine (même si des chefs de clans ont pu être des femmes, mais jamais au sommet de la coupole). Ce qu'a pu réaliser Letizia Battaglia est d'avoir su imposer d'autres règles pour l'existence d'une femme - d'une femme passionnée et qui a voulu découvrir tous les aspects d'une cité si étranges ou les plus grandes beautés du passé voisinent avec les horreurs du présent. Sabrina Pisu, née à Rome et vivant actuellement à Genève, elle-même grand reporter, a tenu tirer la somme de l'expérience peu commune de cette femme qui s'est emparé d'un appareil photographique pour relater les évènements sans jamais chercher à les rendre plus atroces qu'ils ne sont, mais sans non plus y apporter une touche légendaire ou hautement mystique. Elle veut en tirer une philosophie qui pourrait avoir des affinités avec la pensée de Maurice Blanchot. Elle ne s'évertue pas à mettre en exergue les traits de caractère de cette figure extraordinaire, mais plutôt un mode de pensée profond et généreux alors qu'elle a eu le plus souvent affaire avec la mort et l'horreur. Cette approche permanente de la cruauté et du bestial ne l'a jamais empêchée de jouir des joies de la vie et des bontés insignes de sainte Rosalie, qui a sauvé Palerme de la peste en décidant de ressusciter pour sauver ses habitants de la contagion.
Je ne peux que recommander aux lecteurs de se plonger dans ce libre car il fera la connaissance de Letizia Battaglia, mais aussi parce qu'il pourra comprendre qu'elle n'a jamais vécu la photographie comme un art, mais comme un pur moyen de toucher du doigt la vérité sans la moindre pruderie et surtout sans rien enlever à la froide brutalité des faits. Sa force de caractère lui a permis d'engranger un trésor des milliers de clichés qui conserveront à jamais l'aspect obscur ; abject, mortifère de ces lieux solaires. Les vérités dures, implacables et choquantes préservées par cette femme courageuse demeureront enfouies dans nos coeurs, comme autant de blessures atroces, pour nos souvenir que Palerme possède trois cimetières gigantesques dont l'étendue est plus ample que ses confins.
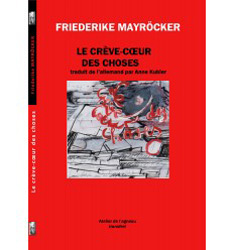
Le Crève-coeur des choses, Friederike Mayröcker, traduit de l'allemand par Anna Kubler, Atelier de l'Agneau, 126 p., 22 euro.
Je dois avouer que j'ignorais tout de cet auteur. Friederike Mayröcker (1924-2021) est l'auteur de nombreux ouvrages dont six ont été traduits par les Éditions de l'Agneau, dont le dernier en date est Le Voyage dans la nuit. Ce volume, qui est tout sauf un roman, a paru en 1985 à Francfort. Il me semble d'ailleurs impossible de le classer dans une quelconque catégorie. Il y a certainement une dimension autobiographique dans ces pages. Mais celle-ci est brouillée par cette écriture qui est en grande partie onirique. De plus, on y découvre des curiosités typographiques : si la ponctuation traditionnelle est respectée en général, les phrases ne commencent jamais avec une majuscule.
Certes, le Nouveau Roman, et en particulier Nathalie Sarraute nous avait habitué à des formes peu conventionnelles et en tout cas troublantes. L'écrivain a ici repris l'esprit de ces transgressions qui dénaturait les codes de l'écriture pour une nouvelle conception de la littérature. Dans le cas présent, cette manière de maltraiter les conventions en vigueur dans une narration admise par tous pour rendre ce qui est du ressort du rêve plus saillant. Nous sommes même assez loin du Bateau ivre d'Arthur Rimbaud ou des Chants de Maldoror de Lautréamont. Cela ne signifie pas que ces lignes soient illisibles, mais il faut accepter de se plonger dans ce flux et de se laisser emporter. Ce périple est ponctué de réminiscences, de sentiments, de jubilations et de chagrins, de fragments d'histoire, de mille choses qui font découvrir la véritable nature de la narratrice. Son ambition n'est pas de nous séduire par son chant ou par sa poésie. Son idée première est que nous découvrions ses pensées les plus secrètes et les circonvolutions de son inconscient. Ce n'est que par cette méthode qu'elle peut se révéler sans révéler ce qu'il y a de plus secret en elle. Il est à noter qu'elle se révèle plutôt pudique et qu'elle ne relate ce qui l'habite que par le biais de ce récit fragment et largement ésotérique. En coupant tous liens avec les genres que nous connaissons et aimons, elle a désiré engendrer une relation qui est profondément énigmatique et, pourtant, des plus intimes.
C'est là le mystère de cette prose endiablée faite pour nous égarer, mais aussi pour nous rapprocher car ce qui s'insinue dans ce texte a été conçu pour que nous puissions goûter le plaisir de ces confessions dont l'essentiel nous échappe. Et c'est justement ce qui nous échappe qui nous permet de pénétrer dans un univers fantasmagorique et qui parvient à nous séduire en dépit de sa bizarrerie. Des paysages se forment et s'évanouissent tout d'un coup, des scènes languides succèdent à des scènes tristes et mélancoliques. Des images s'esquissent, des moments passés ressuscitent, des enchaînements incongrus se dessinent : Friederike Mayröcker avait le don de produire des chapitres obscurs et néanmoins attirants. Si nous nous égarons dans son labyrinthe de phrases souvent décousues c'est que le jeu en vaut vraiment la chandelle. Oui, nous sommes perdus et, au bout du compte, nous nous retrouvons unis à cette femme de lettres qui n'a jamais eu peur de transgresser la grammaire de fer qui préside à toute création.
Ce Crève-coeur des choses a donc ce pouvoir paradoxal de déranger, de s'éloigner du réel et, en dépit de tout, de plaire en dépit de son caractère cryptique. C'est une curiosité dans la sphère des lettres et en même temps une tentative d'attribuer à la fiction une nouvelle orientation.

Georges de La Tour
En France, au début du XVIIe siècle, on considère encore que l'art puise ses sources en Italie. Giorgio Vasari et ses pairs demeurent les historiens et les partisans de cette vision qui veut que tout a commencé avec Cimabue et Giotto. Un peintre français, qui s'est rendu à Rome, Nicolas Poussin (1594-1665), a imaginé un genre de peinture novatrice qui va inciter des amateurs éclairés à le désigner comme le point de départ d'une nouvelle conception de l'art qui provoque une rupture avec cette tradition née de l'autre côté des Alpes, et que l'art nouveau et ont affirmé la suprématie d'une nouvelle école qui ne réfute pas avec ce passé prestigieux de la peinture, mais qui prend le relais sous d'autres cieux. Cette révolution, annoncée par André Félibien et un certain nombre de ses contemporains, fait de Poussin l'incarnation de cette transition sans retour. Cela se passe sous le règne de Louis XIII et trouve son accomplissement dans son fils, Louis XIV, qui désire que toute la création (de la musique à la littérature, en passant par le théâtre et la sculpture) se développe autour de son pouvoir absolu. Il faut se souvenir que François Ier et que Henri II avaient fait appel à des peintres italiens (comme Rosso et Primatice) pour décorer le palais de Fontainebleau. Pour décorer Versailles on fait appel à des artistes français dont le plus éminent est Charles Le Brun.
Aux côtés de Nicolas Poussin, il faudrait placer Georges de La tour (1593-1652) dont on sait si peu de choses jusqu'à sa venue à Paris (il s'est marié en 1617, le couple a eu dix enfants et s'est installé à Lunéville, encore sous la domination d'Henri II de Lorraine, jusqu'en 1638, année du siège de la ville, qui le contraint à s'installer à Nancy - il semble avoir exercé plusieurs activités commerciales ou artisanales). La première mention d'une vente d'un tableau - Madeleine - est avérée en 1640.Il a su tant plaire à Louis XIII (il est à son service depuis 1639), qui a enlevé tous les tableaux de sa chambre pour y placer son Saint Sébastien. Fils de boulangers, on ignore presque tout de sa jeunesse et par conséquent de son éducation. Il a choisi de réaliser son oeuvre dans l'esprit du ténébrisme, mais pas comme tous ceux qui ont marché dans les pas du Caravage, comme Vien, Tournier, Vouet et quelques autres Il exécute une Nativité en 1640. Il signe une oeuvre en 1645, Les Larmes de saint Pierre. Suit le Souffleur à la pipe un an plus tard. Il peint un Saint Alexis en 1648. Il fait un Saint Sébastien en 1649. Et en 1651, il peint Le Reniement de saint Pierre. Il meurt en 1652.
Cette biographie très lacunaire ne permet pas de comprendre quelle a été la carrière de cet homme qui est parvenu à imaginer un genre de peinture tout à fait original. Et, contemporain des grands ténèbristes français, il ne tire pas son inspiration du Caravage et de ses émules transalpins. Il invente une façon tout à lui de conjuguer les ombres et la lumière, tout en imprimant à ses compositions une sorte de tendresse et de doux mystère. Même dans les scènes les plus mystiques (la majorité de ses oeuvres sont religieuses), on ne verra jamais se dégager une tonalité violente ou tragique. On trouve plutôt un sens profond de concentration profonde, une rare intensité. La palette chromatique repose toujours sur le rouge et le noir. Peu d'autres couleurs sont utilisées, sinon pour les vêtements, qui sont simples et de teintes unies, et un peu de blanc vient accentuer les zones plongées dans les ténèbres et les autres éclairées par la lueur des bougies. Il faut remarquer que certaines pièces lui sont attribuées et d'autres sont indiquées comme sortant de son atelier - mais a-t-il eu vraiment un atelier dans le sens où il aurait eu des assistants et des élèves ? D'autant plus que les ouvrages qui auraient pu être exécutées par ces disciples ou suiveurs ont été élaborées par d'excellentes mains. Toutes sont faites dans son esprit au point de pouvoir presque les confondre. Ce que nous enseigne cette belle exposition et ce riche catalogue c'est que pendant quelque temps ; il y a eu un réel engouement pour son style et aussi pour son univers si particulier. Il est évident qu'il a joué un rôle important dans la naissance de cet art français prédominant. Il a été parmi les premiers à faire une rupture décisive avec les grands modèles italiens.
Si vous n'avez pas pu voir cette exposition remarquable, l'excellent catalogue vous offrira le moyen de connaître avec précision quel a été sa facture et son écriture picturale.

Paolo Roversi, Chiara Bardelli Nonino, « Photo Poche », Actes Sud, 144 p., 14, 50 euro.
La photographie a pris une place toujours plus considérable dans la sphère de l'art contemporain et sous les formes les plus diverses. Aucune frontière ne semble en mesure de freiner cette expansion exponentielle. Cela est dû à de nombreux facteurs, dont la facilité technique, aux antipodes de ce qui s'est fait au XIXe siècle, qui exigeait des connaissances sérieuses dans le domaine de la chimie et qui exigeait des manipulations compliquées autant pour les prises de vue que pour le développement des clichés. De nos jours, rares sont les artistes qui ont recours à l'argentique. Les appareils actuels et les ressources insondables des ordinateurs ont ouvert des voies nouvelles et offert une liberté immense à tous ceux que cette technique intéressait sans avoir besoin de connaissances approfondies. Cela ne veut pas dire que ces créateurs soient tous dénués de talent. Mais il est évident que l'expérience requise pour la peinture, la sculpture et tous les arts appliqués traditionnels, n'est plus de mise. Cette belle collection qui paraît chez Actes Sud permet de découvrir ou de mieux connaître les photographes qui se sont fait connaître dans ce domaine.
Paolo Roversi est né à Ravenne en 1947. On lui a offert son premier appareil photographique alors qu'il avait huit ans. Il n'a plus cessé dès lors de se passionner pour ce mode d'expression sans jamais explorer ses aspects techniques. Ce qui l'intéressait le plus tenait dans la composition et la lumière. Il a commencé par faire des reportages comme la venue de la compagnie américaine du Living Theater ou les funérailles d'Ezra Pound. Mais il comprend très vite que ce n'est pas son orientation. Il se rend à Paris en 1973. Il trouve un atelier et commence à imaginer des compositions qui étaient des sortes de petits théâtres imaginaires à partir des données du réel. S'il a fait beaucoup de nus, il a multiplié le nombre de ses sujets. Un objet peut l'intéresser tout autant qu'une figure. Si ses compositions suivent des schémas très différents, il y a au moins un point qui les lie les uns autres : le souci de l'esthétique. Cela ne signifie pas que Roversi a désiré tisser des liens avec ses prédécesseurs de l'entre-deux-guerres qui étaient habités par le sens de la construction et de l'imaginaire abstrait ou simplement formel. Mais quelque soit le sujet traité, il a souhaité qu'il apparaisse sous un éclairage esthétique parfait. C'est d'ailleurs ce qui le distingue de la plupart de ses contemporains. Il a fui le fugace et le furtif, le chaos et l'aléatoire. Son pont de départ peut fort bien être né d'un concours de circonstances imprévus, mais il l'élabore de sorte à ce qu'il distille une idée de beauté. C'est dans nul doute une quête un peu paradoxal, mais qu'il maîtrise à la perfection. Il utilise aussi bien la couleur que le noir et blanc et aime faire poser ses personnages. Il a chez lui un penchant pour un genre de classicisme, mais en le plaçant dans une optique qui peut être baroque, onirique ou fantasque. La mise en scène lui est indispensable. Et même le plus incongru prend avec lui une apparence séduisante. En ce sens, il se distingue par son originalité et sa créativité. Rien ne pourrait lui faire renoncer à cette quête passionnée pour ce qui ne peut être qu'un rêve qui se matérialise à partir de ce que le monde lui offre ou quand il a l'intention de changer une robe et son modèle en un « tableau » qui ne peut être fait que par les moyens qui sont les siens.
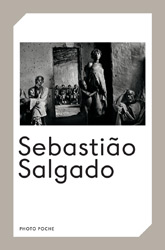
Sebastiao Salgado, Christian Caujole, « Photo Poche », Actes Sud, 144 p., 14, 50 euro.
Il est né à Aimorès, au Brésil, en 1944. Il a fait une carrière d'économiste. C'est à Paris en 1873 que lui est venue cette passion exclusive pour la photographie. Il a dès lors travaillé pour de grandes agences, comme Sygma ; Gamma et Magnum. Par la suite il a été à l'origine de la fondation de l'agence Amazonas images, où est le seul maître des thèmes abordés. Il n'a eu aucun penchant pour une photographie de nature artistique : seul l'humain, dans ce qu'il peut avoir de plus troublant et de plus pathétique l'a intéressé. Il a voulu faire voir la misère, la maladie, les maux qui ravagent les régions les désolées et les plus pauvres du monde. Il voulait nous faire percevoir ce qu'il y avait de plus terrible dans notre monde. Jamais il n'a voulu tirer une once de pittoresque ou d'admirable dans ses prises de vue. Au contraire : il a recherché la vérité la plus crue. Il ne fournit jamais une justification de quelque nature à ce qu'il a pu ramener de ses voyages en Afrique ou aux Indes. Il est présent là où plus rien ne peut être pittoresque. Il est demeuré toute sa vie durant un témoin qui est là pour nous faire prendre conscience des malheurs qui s'abattent sur des populations qui sont dépouillées ou chassées de leurs territoires par les guerres ou les caprices du climat. Il s'est fait un nom alors que ses photographies ne sauraient séduire le moindre amateur d'art. C'est l'aridité de sa quête exigeante, sa vision sans concession et ses scrupules qui dénotent un humanisme généreux. Bien sûr, on pourrait voir en lui une sorte de missionnaire, mais qui n'a pas de message à divulguer aux peuples qu'il rencontre, mais à nous autres sur notre Vieux Continent. Il ne tient pas à noircir le tableau, mais il est déterminé à ce que nous puissions voir comme lui l'a vue la désespérances des êtres malmenés par le destin et par les horreurs de contrées qui connaissent les pires tourments.
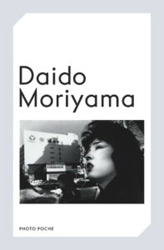
Daido Moriyama, Gabriel Bauret, « Photo Poche », Actes Sud, 144 p., 14, 50 euro.
Daido Moriyana (né en 1938 à Ikeda) s'est imposée comme l'une des photographes les plus en vue dans son pays. Sa participation à la revue Provoke à la fin des années soixante, puis ses très nombreuses publications ont contribué à la rendre célèbre. Elle appartient à cette foule de photographes qui ont choisi la ville comme terrain de jeu. Ce qui la distingue de tous, ce n'est pas tant le style, qui est, en apparence peu soigné, comme si le cliché était né du hasard, mais d'un goût prononcé pour les détails. A Tokyo, elle a parcouru de long en large le quartier de Shinjuku, qui est si animé. Elle n'en retient pas les passants ou encore le décor, mais plutôt des détails qui peuvent révéler l'état d'âme d'un lieu, avec ses surprises, ses défauts, ses curiosités.
Elle ne part pas à la recherche de l'insolite ou du fantastique, mais de signes qui se chevauchent et se contredisent. Rien ne répond chez elle à un ordre ou à une vision préconçue du monde d'aujourd'hui. Bon nombre de ses clichés se présentent comme un assemblage, qui est souvent une accumulation de choses disparates. Pour elle, le monde citadin est un mélange insolite et imprévu d'objets et parfois de personnes qui révèlent la discontinuité visuelle qui se délivre lorsqu'on se promène dans les rues d'une ville moderne. Elle aime beaucoup des portraits d'inconnus qui sont des figures étonnantes et d'artères qui semblent avoir échappé à l'uniformité générale. Toutes ses captures d'images d'êtres humains sont placées à l'enseigne de la singularité. Elle tient d'abord à sortir des sentiers battus et de faire découvrir des scènes qui ne sont pas communes. C'est, en somme, une manière de ressentir ce qui fait la vérité d'un monde qui repose sur une foule de contradictions et même d'aberrations visuelles. Elle est certainement l'un des protagonistes de cette manière de mettre en scène ce qui est le contrepoint des grands projets d'urbanisme où l'ordre et la norme sont remis en question.
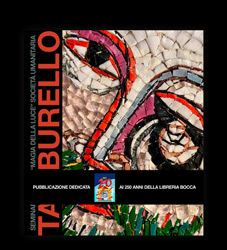
Tamburello - Seminari mostra « magia della luce », sous la direction de Tina Taglieri, Libreria Bocca, Milan.
Sans doute le nom de Concetto Tamburello ne vous est pas familier. Et peut-être même inconnu. C'est dommage car c'est un artiste remarquable. Et aussi vraiment loin de tout ce qui peut se faire à l'heure actuelle. Il est figuratif, mais il utilise ses figures d'une manière surprenante en composant des frises et des combinaisons singulières. Il aime jouer sur le registre de la répétition et de la contamination. En somme il associe l'ordre et une vision quelque peu dionysiaque. Toutefois, il est attaché à la création d'un univers qui allie l'ancien et le moderne et repose sur des jeux optiques savants. Tout ce qu'il peint est d'une perfection qui se traduit par un paradoxe jubilant, donnant souvent la sensation d'un saisissant mouvement de figures intrigantes. Chaque tableau délivre une sensation nouvelle même s'il entretient des liens étroits avec les autres par son style et ses agencements ludiques. Il est difficile de déchiffrer ses associations entre tous ses personnages qui appartiennent à sa mythologie profonde et secrète. Il met à jour les mouvements de son esprit bien dissimulés dans son for intérieur, alors qu'il affiche tous ses acteurs emportés par un mouvement harmonieux et vertigineux. C'est chaque fois une énigme et chaque fois un enchantement.
Né en 1947 dans un petit village sicilien, San Stefano di Camara, où travaillent depuis des générations d'habiles potiers et céramistes. Leur dextérité et leur savoir-faire l'ont profondément influencé. Et il s'est mis à réaliser à son tour des vases et toutes sortes d'objets en céramique dont les formes sont la plupart du temps originale et qui échappe à toute fonction utilitaire. Cependant, il ne recherche pas les objets les plus extravagants, au contraire. Il demeure fidèle aux formes classiques, les interprétant volontiers selon sa disposition d'esprit. Et comme on peut le voir dans ce magnifique ouvrage, il les recouvre de peintures, toutes plus sophistiquées les unes que les autres. Il passe sans problème d'une certaine abstraction à des scènes narratives très poussées en fonction de son désir du moment. Il n'a pas de frontières précises dans la disposition des couleurs ni dans la relation au sujet qu'il entend traiter. Sa grande liberté dans les thèmes retenus ne procure pas la sensation d'une dispersion ou d'un chaos plastique.
Au contraire. On reconnaît sans difficulté sa main en dépit de ces grands écarts entre les oeuvres qu'il a conçues. La majorité d'entre elles sont des vases, qui ne sont pas de la même facture, comme si ces variations géométriques donnaient à ses peintures une dimension différente. On ne peut qu'être émerveillé par leur perfection matérielle et par sa manière de leur donner une vie autonome par le pinceau. Son répertoire est presque infini. Et la beauté n'est pas pour lui le fruit d'une action répétitive ou d'un catalogue de dessins déjà établis. Il invente pour chaque objet une nouvelle imagerie, qui peut avoir des liens avec les précédentes et les suivantes, sans jamais se ressembler étroitement.
Il a eu aussi une attirance très forte pour la technique de la mosaïque et il a réalisé de nombreux ouvrages dans cette perspective. Cet art nécessite une habilité sans faille. Il semble à l'aise en ajustant les tesselles et en suivant le modèle qu'il avait élaboré dans son crâne. Il parvient à produire un schéma très complexe sans apparente difficulté. Ses compositions sont assez différentes de ses oeuvres peintes, sans doute que cette pratique lui a ouvert de nouveaux horizons. En sorte qu'il a pu concevoir d'autres « tableaux » avec des impératifs inédits. Il ne fait pas référence à la mosaïque antique, mais tient à ce qui sort de son atelier continue à concilier l'ancien et le moderne, car c'est son crédo de base. Bien sûr, il n'y a rien d'intemporel dans ce qu'il crée. Mais cela n'appartient à aucun courant existant. Il ne fait d'ailleurs aucune référence à des tendances qu'il a pu connaître au fil du temps et s'abstient également de trouver une justification et une protection dans les arts anciens. Il a conservé tout au long de son aventure esthétique une ligne de conduite égocentrique, qui est loin d'être un défaut. Il a su aussi faire évoluer son mode de peindre ou de proposer des formes avec des matériaux éloignés de la peinture, étant toujours capable de métamorphoser son approche des couleurs et des lignes. Il a été en quête d'un monde qui ne pouvait se révéler que par cette conception à laquelle il n'a pas un instant renoncé, mais aussi avec une pleine liberté qui rend tout ce qu'il a fait véritablement unique et fascinant.

Concetto Tamburello
Niente è più difficile che collocare l'approccio di Concetto Tamburello in una prospettiva qualsiasi, credo di averlo già detto. Ciò che colpisce innanzitutto è che le sue opere presentano un evidente orientamento decorativo, ma, ripeto, senza essere realmente in grado di inscriverlo in una dimensione specifica della nostra storia dell'arte. Poi, ha suonato su registri in cui l'astratto e il figurativo si fondono senza essere determinati da regole fisse. È impossibile dire se appartengano a registri, se siano arcaici, classici, romantici, modernisti, ecc. Sembra emergere solo un'idea narrativa, ma non attingendo le sue fonti da uno o più generi ben definiti. Se l'insieme si basa su un grande rigore formale, la commistione dei toni rivela una sorta di visione carnevalesca dove il tragico e il comico si intrecciano. Molto furbo sarà colui che penserà di riuscire a trovare una categoria in cui inserire queste strane scenografie. Senza dubbio, raccontano una storia, ma sfugge alla decifrazione. Qualunque cosa sia, è impossibile nasconderla, perché è ciò che dà il tempo e le risonanze armoniche dell'insieme. Da parte mia, li considero come frammenti autobiografici dell'autore, senza possederne la chiave. Ma potrei sbagliarmi. Potrebbero benissimo essere reminiscenze della sua infanzia, o sogni che sono stati organizzati su una specie di treno fantasma di un luna park irreale. La sua intenzione non è quella di rivelarsi davanti a noi, ma di tradurre ciò che lo abita nel linguaggio della pittura (o di altre tecniche che pratica volentieri), operando così una distorsione semantica che cela ciò che è privato. Insomma, ci racconta molto di chi è, di ciò che gli piace, di ciò che ha adottato nell'enorme serbatoio della nostra cultura e delle sue passioni più nascoste e sgradevoli.
In realtà, le opere di Tamburello sono delle trappole. Trappole ottiche in primis, va da sé, ma anche trappole narrative. Più ci avviciniamo a loro, più ci rendiamo conto che si dispiegano su più strati. Il che non è ovvio a prima vista. Le sequenze si svolgono su piani diversi, su scale diverse. In modo che la narrazione che ha preparato per noi sia un groviglio di storie che hanno legami tra loro, ma che attirano l'occhio in più direzioni. Gli accostamenti di colori contribuiscono a rendere meno evidenti questi percorsi narrativi. Allo stesso tempo, contribuiscono molto a dare una profondità ancora più ampia a questi frammenti di discorso che sono discontinui, stabilendo (paradossalmente) una continuità. Quest'ultimo è un'esca. Ciò che viene rivelato ha un'intensità che è sostenuta da una coerenza architettonica. Ogni dettaglio lo smentisce non appena si ha il desiderio di scoprirli da vicino. Un dipinto, soprattutto con fondo oro, è una totalità indissolubile. Ma i suoi elementi sono disparati e, a volte, contraddittori. Un dipinto è uno e plurale allo stesso tempo. Questo può dare l'impressione di provocare qualcosa che sarebbe discordante, il che non è il caso. Il suo virtuosismo ludico è proprio quello di affidarsi a questi diversi piani e a queste congiunzioni, più complesse di quanto immaginiamo, in primo luogo, che l'esercizio della pittura decide in base a un'estrapolazione che appartiene solo a lui.
Il rapporto che egli spera di instaurare con gli spettatori che siamo è quindi duplice. Da un lato, c'è la volontà di proporre un tutto che generi un tutto e quindi non metta in discussione la coerenza della sua invenzione. D'altra parte, la superficie diventa sempre più criptica man mano che viene esplorata. L'illusione che propone non è dell'ordine della somiglianza e nemmeno di un'idea che si può avere di un argomento trattato. Ci porta a sperimentare ciò che gli astronomi sperimentano quando avanzano nella loro conoscenza dello spazio siderale. La scoperta di una galassia sconosciuta porta alla scoperta di molte altre galassie. L'infinito non è dimostrato, ma è allora manifesto che deve esistere. Albert Einstein pensava che lo spazio fosse finito. Dopo un po' di tempo, ha rinunciato a questa ipotesi senza essere in grado di dimostrare ciò che stava dicendo. Nel caso di Concetto Tamburello, la questione si pone in altri termini, ovviamente. Resta il fatto che il suo microcosmo è anche un macrocosmo e che ciò che ci racconta è solo una piccola parte del suo immenso grimorio che, invece di diminuire man mano che avanza nella sua concezione, diventa solo ancora più grande e travolgente. Honoré de Balzac dovette rivedere al ribasso la portata del suo progetto romanzesco perché si rese conto che non avrebbe avuto abbastanza vita per realizzarlo (non sapeva ancora che sarebbe stato così breve). Per il nostro artista, la progressione del suo lavoro non fa che aumentarne i confini. La sua esperienza gli porta costantemente nuovi materiali per costruire questo colossale monumento che trova la sua ragion d'essere solo in questo continuum che è come un'onda che lo sommerge di parole e immagini, situazioni incongrue e rivelazioni estemporanee. Ci sono artisti che si inaridiscono con l'età (Pierre Renoir per citarne solo uno), si inaridiscono, e altri che sbocciano sempre di più, con la tendenza a muoversi verso una nuova infanzia nonostante tutta l'esperienza già consumata. E c'è chi va e viene tra due temporalità, chi avrebbe potuto rallentarle e chi, al contrario, è il motore di un rinnovamento permanente.
Così, il suo cammino interiore diventa, se vogliamo, il nostro, ma in termini molto diversi. Siamo condotti a vivere una ricerca estetica che si carica di mille bagagli esistenziali e culturali. E questo è il suo invito al viaggio, che è davvero un piacere e un interrogativo senza fine, perché le sue creazioni sono così seducenti e sconcertanti, belle e misteriose.
|
Gérard-Georges Lemaire
04-12-2025 |
|
|
| Verso n°136
L'artiste du mois : Marko Velk
|
POUR UNE AUTRE PHOTOGRAPHIE…
Esther Ségal
|
visuelimage.com c'est aussi
|
Afin de pouvoir annoncer vos expositions en cours et à venir
dans notre agenda culturel, envoyez nous, votre programme, et tout
autre document contenant des informations sur votre actualité à : info@visuelimage.com
ou par la poste :
visuelimage.com 18, quai du Louvre 75001 Paris France
À bientôt.
La rédaction
Si vous désirez vous désinscrire de cette liste de diffusion, renvoyez simplement ce mail en précisant dans l'objet "désinscription". |
|
